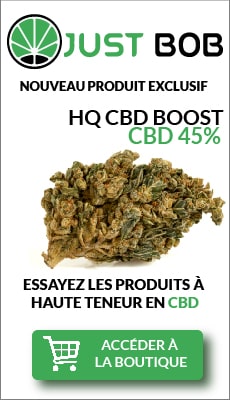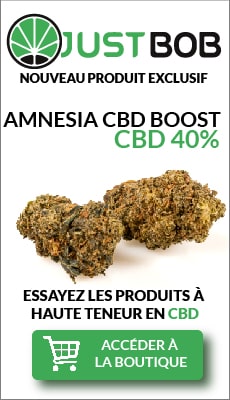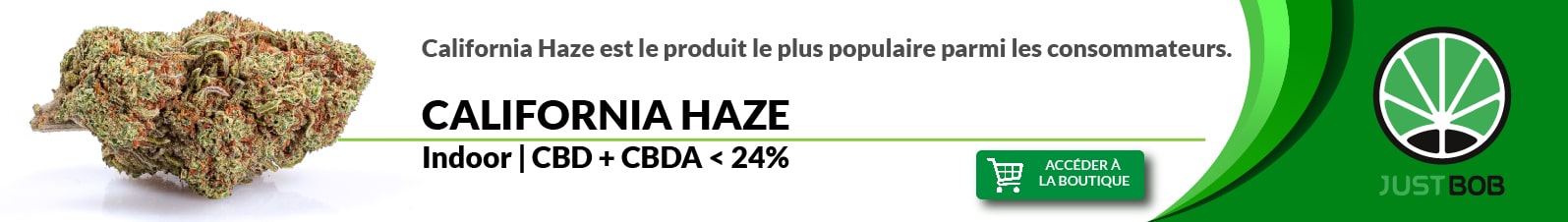Publié le: 13/11/2025
La saisine du Conseil d’État ouvre une voie décisive qui pourrait renverser des années d’incertitudes, de restrictions et de contradictions législatives
L’Italie se retrouve au centre d’un contentieux qui dure depuis des années, et qui concerne le chanvre industriel, un secteur agricole en forte croissance grâce à la demande croissante de produits contenant du CBD et d’inflorescences à faible teneur en THC.
Il s’agit d’une filière qui réunit des milliers d’entreprises et qui, dans une grande partie de l’Europe, fonctionne avec des règles claires. Le chanvre issu de variétés certifiées est considéré comme un produit agricole ordinaire. En Italie, toutefois, le cadre réglementaire est devenu de plus en plus confus. Des lois contradictoires, des recours, des saisies et des décisions de justice se sont superposés jusqu’à créer une situation paradoxale, où un produit légal dans de nombreux États membres est traité comme une substance stupéfiante.
Dans ce contexte complexe, une ordonnance du Conseil d’État italien (qui est la plus haute juridiction administrative du pays) a décidé de saisir la Cour de justice de l’Union européenne. La question posée est la suivante : lorsque les inflorescences de chanvre proviennent de variétés certifiées et contiennent une quantité minimale de THC, s’agit-il d’un produit agricole protégé par le droit de l’Union ou peuvent-elles être interdites comme s’il s’agissait de stupéfiants ?
La réponse déterminera l’avenir de la filière italienne et la cohérence de son cadre réglementaire avec celui des autres pays européens.


La longue généalogie d’un conflit : comment l’affaire est arrivée devant la Cour de l’UE
Le dossier remonte à 2022, lorsque la Conferenza Stato-Regioni (l’organisme où l’État et les régions italiennes coordonnent les matières législatives) a approuvé un décret classant le chanvre parmi les plantes officinales, tout en limitant son utilisation à la fibre et aux graines. Cette mesure, introduite sous le gouvernement Draghi, semblait technique, mais elle est rapidement devenue le point de départ d’un contentieux.
Les principales associations du secteur, dont Canapa Sativa Italia, Federcanapa, Sardinia Cannabis et Resilienza Italia, ont contesté le décret devant le TAR Lazio (un tribunal administratif régional). Elles estimaient qu’aucune base scientifique ne justifiait l’interdiction des fleurs de cannabis sativa issues de variétés certifiées à faible teneur en THC.
En février 2023 le TAR leur a donné raison, annulant la partie du décret limitant l’usage de la plante et affirmant qu’un simple recours au principe de précaution ne peut suffire sans preuves scientifiques. Le tribunal s’est appuyé sur des précédents européens, notamment la décision Kanavape de 2020, qui reconnaissait que le CBD n’est pas un stupéfiant et que ses dérivés doivent pouvoir circuler librement dans l’Union.
Avec l’arrivée du gouvernement Meloni, les ministères de l’Agriculture, de l’Environnement et de la Santé ont fait appel, rouvrant un conflit qui s’était entre-temps complexifié. Un nouveau Décret Sécurité avait introduit une interdiction générale des inflorescences, les assimilant à des stupéfiants quelle que soit leur teneur en THC.
C’est dans ce climat que le Conseil d’État a examiné l’affaire, pour arriver finalement à une conclusion différente de celle recherchée par l’exécutif.
Les nœuds juridiques qui ont conduit le Conseil d’État à demander l’avis de l’Union
L’ordonnance du Conseil d’État expose une série d’incohérences qui ne peuvent être résolues sans l’intervention du droit européen.
Les juges partent d’un constat souvent ignoré dans le débat politique : le droit européen ne distingue pas les différentes parties de la plante de chanvre. Il ne sépare pas la fibre et les graines des feuilles et des inflorescences. Les variétés autorisées sont les mêmes et la limite de THC établie par la législation européenne s’applique à l’ensemble de la plante.
Cela soulève une première question centrale : une législation nationale peut-elle interdire l’usage et la commercialisation des inflorescences lorsqu’elles proviennent de variétés certifiées et respectent les seuils de THC fixés par l’Union ?
Le risque d’une violation des articles 34 et 36 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui garantissent la libre circulation des marchandises, est évident. Face à un THC qualifié d’« extrêmement faible », la justification de santé publique devient fragile et disproportionnée.
Le deuxième problème concerne le Testo Unico sugli Stupefacenti (la loi italienne sur les stupéfiants). En Italie, fleurs, feuilles, huiles et résines sont inscrites en tableau II sans aucun seuil.
Une classification aussi absolue entre en tension avec la Politique agricole commune, avec les règles européennes de concurrence et avec les décisions de la Cour de justice affirmant que le CBD n’est pas une substance psychotrope. Cette superposition du droit agricole et du droit pénal est au cœur du blocage actuel, qui se retrouve désormais entre les mains de la Cour de justice.
Effets immédiats et scénarios possibles : ce qui change pour les entreprises et les tribunaux
La saisine de Luxembourg a un effet immédiat : elle suspend la procédure italienne.
Le Conseil d’État ne rendra pas de décision définitive tant que la Cour de justice n’aura pas fourni son interprétation. Mais les effets iront probablement plus loin. Les juridictions civiles, pénales et administratives pourraient elles aussi suspendre leurs affaires, en attendant la réponse liée à la compétence européenne.
Selon l’avocat Giacomo Bulleri, qui représente les associations requérantes, cette suspension pourrait déclencher un véritable effet domino. De nombreuses affaires pourraient être regroupées ou gelées, réduisant le risque de condamnations ou de saisies qui pourraient s’avérer infondées.
Les enjeux économiques sont considérables. La filière italienne du chanvre compte des milliers d’entreprises et des dizaines de milliers de travailleurs dans l’agroalimentaire, les cosmétiques, les herbes médicinales, les compléments et l’horticulture.
Une interdiction générale des inflorescences, un produit largement commercialisé dans le reste de l’Europe, pénalise un marché qui, paradoxalement, a pris naissance en Italie en 2017. La demande européenne est forte et en croissance, alors que l’approche restrictive italienne risque d’isoler une filière que d’autres pays traitent comme agricole.


Un test de cohérence européenne : les enjeux dépassent le chanvre
La décision de la Cour de justice ne touchera pas seulement le marché du chanvre. Elle clarifiera la possibilité pour un État membre d’imposer des restrictions à un produit agricole que le droit de l’Union intègre dans le marché intérieur.
Si la Cour constate un conflit entre la loi italienne et le droit européen, les dispositions incompatibles seront automatiquement écartées. Il ne s’agit pas d’un choix politique, mais d’un mécanisme prévu par les traités : le droit de l’Union prévaut lorsque la norme nationale contredit des principes tels que la libre circulation des marchandises ou la proportionnalité.
C’est pourquoi la saisine du Conseil d’État a une portée bien plus large que le seul secteur du chanvre. Elle révèle une tension profonde entre la politique nationale et les obligations européennes. D’un côté un secteur agricole innovant, reconnu dans la plupart des pays européens. De l’autre un cadre réglementaire italien qui continue de considérer les inflorescences comme des stupéfiants, sans tenir compte du THC ni des données scientifiques.
Une occasion de ramener de la clarté dans un débat déformé
L’intervention de la Cour de justice permettra d’établir un cadre juridique plus solide que les allers-retours législatifs des dernières années.
Quelle que soit la décision finale, l’Italie devra faire face à des années de contradictions qui ont désorienté entreprises, consommateurs et institutions. Si l’Union confirme que le chanvre industriel est un produit agricole à part entière, comme l’indiquent déjà plusieurs règlements et décisions, il deviendra difficile de justifier les saisies, les poursuites pénales et les interdictions généralisées des inflorescences et du CBD.
Dans les mois à venir, l’Italie sera confrontée à un principe longtemps ignoré : la politique agricole et la politique des stupéfiants ne peuvent se superposer sans créer de profondes distorsions.
La décision de Luxembourg sera un tournant. Et elle marquera peut-être le début d’une approche plus rationnelle, moins idéologique, capable de reconnaître une filière qui demande simplement des règles claires, cohérentes et fondées.
C’est tout pour l’instant. Nous vous tiendrons au courant de l’évolution de la situation ici même, sur Justbob !
La bataille italienne sur le chanvre arrive en Europe : takeaways
- La décision du Conseil d’État italien de saisir la Cour de justice de l’Union européenne révèle un conflit profond entre la réglementation nationale, qui assimile encore les inflorescences de chanvre à des stupéfiants, et le droit européen, qui considère le chanvre issu de variétés certifiées comme un produit agricole soumis à la libre circulation. Cette contradiction met en lumière un cadre italien devenu incohérent et difficilement compatible avec les règles du marché intérieur.
- Le renvoi à Luxembourg a un effet immédiat de suspension sur la procédure italienne et pourrait entraîner un gel d’un grand nombre d’affaires civiles, pénales et administratives liées au chanvre. Pour une filière composée de milliers d’entreprises, cela signifie moins de risques de saisies et de condamnations, dans l’attente d’une clarification européenne qui pourrait redéfinir l’ensemble du secteur.
- L’arrêt attendu de la Cour de justice aura une portée qui dépasse largement le chanvre : il déterminera jusqu’où un État membre peut aller lorsqu’il impose des restrictions à un produit agricole autorisé au niveau européen. Une éventuelle incompatibilité de la loi italienne avec le droit de l’Union obligerait à écarter les normes nationales contraires, ouvrant la voie à un cadre enfin clair, cohérent et aligné sur les principes de proportionnalité et de libre circulation.
La bataille italienne sur le chanvre arrive en Europe : FAQ
Pourquoi le Conseil d’État italien a-t-il renvoyé l’affaire des fleurs de chanvre à la Cour de justice de l’Union européenne ?
Le Conseil d’État a posé la question à la Cour de justice car les restrictions italiennes appliquées aux fleurs de chanvre pourraient violer le droit européen. La réglementation de l’UE considère le chanvre industriel comme un produit agricole sans distinguer entre graines, fibres, feuilles ou fleurs. Interdire des fleurs issues de variétés certifiées et contenant très peu de THC risque de constituer une entrave injustifiée à la libre circulation des marchandises et une mesure disproportionnée.
Quels sont les effets immédiats du renvoi du Conseil d’État sur le marché italien du chanvre ?
Le renvoi suspend la procédure en cours et pourrait amener plusieurs juridictions italiennes à attendre l’interprétation de la Cour de justice. Cela réduit la probabilité de saisies, d’enquêtes pénales ou de condamnations dans un secteur déjà fragilisé par des années d’incertitude normative. L’impact économique est considérable, car la filière du chanvre implique des milliers d’entreprises et un marché en pleine croissance.
Que pourrait-il se passer si la Cour de justice juge illégales les restrictions italiennes sur les fleurs de chanvre ?
Si la Cour de justice établit que les fleurs de chanvre à faible teneur en THC doivent être considérées comme des produits agricoles protégés par le droit de l’UE, les restrictions nationales incompatibles ne pourront plus être appliquées. L’Italie devra alors ajuster sa législation à la PAC et au principe de libre circulation, mettant fin à des années de contradictions et d’incertitudes pour les opérateurs du secteur.